(ou le devenir monde de la mémoire)
par Michel Gaillot, 2000
De toute part, on nous annonce l’avènement prochain du “Monde”, sa naissance à lui-même, à sa mondialité, sous la figure du “Village global”, comme si les identités nationales, ethniques, ou culturelles qui le maintenaient jusqu’à présent morcelé, fragmenté, étaient dorénavant vouées à disparaître, à s’effacer, sous l’effet notamment du développement actuel des nouvelles technologies de communication qui les entraîneraient dans un processus irrésistible de déterritorialisation.
D’un autre côté, ces nouvelles technologies affecteraient l’identité humaine non pas seulement au niveau collectif — le corps social —, mais aussi au niveau individuel — dans le corps propre —, dans la mesure où elles tendraient de plus en plus à l’investir et à le modifier en s’immisçant jusqu’au plus profond de sa chair. Du coup, tant sur le plan communautaire que singulier, c’est toute la constitution de l’homme, sa nature, ou la permanence de celle-ci, autrement dit son identité, qui se trouve là bouleversée et rejouée autrement, appelant par là à inventer de nouvelles façons de la définir ou de la penser, ce qui expliquerait sans doute la récurrence quasi-obsessionnelle de ce thème — l’«identité» sur la scène philosophique et artistique de notre modernité.
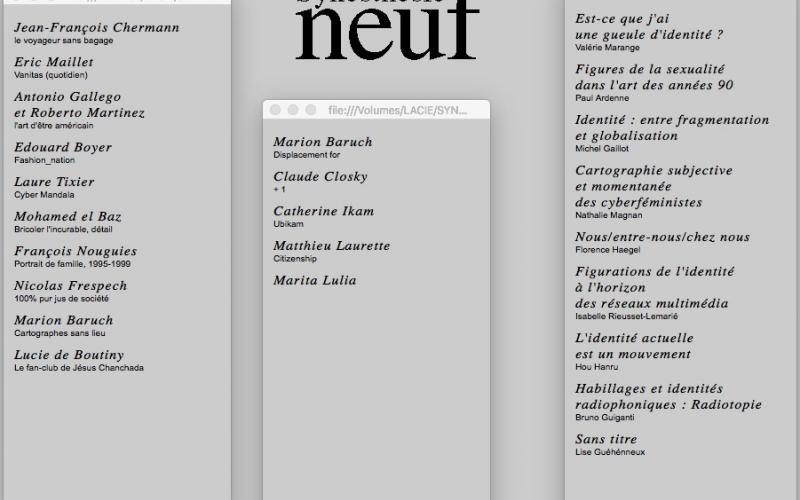
Ainsi, pour autant qu’elle ne concerne pas la similitude de deux êtres, mais la permanence structurelle d’un même être, l’identité suppose en premier lieu l’actualisation continuelle d’un passé, sa rémanence ou la rémanence d’une origine. C’est de la sorte qu’est définie philosophiquement l’identité : “un être reste identique à lui-même dans la mesure où recueillant perpétuellement son passé dans son présent et résumant ses propres changements, il demeure solidaire de sa tradition entière.” 1 L’identité de chaque être dérive en ce sens d’un processus de singularisation ontogénétique dont la réalité pour l’être humain se conserve ou se perpétue dans une constellation complexe d’habitudes relevant de la nutrition, de la langue, de la perception, et plus généralement de la culture.
Pour qu’il y ait identité, il faut nécessairement — c’est sa condition de possibilité —que le passé d’un être se prolonge dans le présent. Autrement dit, l’identité qui permet le rassemblement de la différence en une unité égale à elle-même, n’est identité ou ne le reste qu’en étant toujours activée-réactivée dans le présent. Elle constitue en cela une sorte de mémoire structurelle redondante qui permet à l’individu qu’elle informe et singularise de rester le même : identique à lui-même à travers les multiples et diverses circonstances que lui fait traverser le monde dans lequel elle est nécessairement co-impliquée avec d’autres identités. C’est dire aussi qu’il n’y a pas d’identité sans mémoire, ne serait-ce qu’au niveau ontologique avec la mémoire génétique, ce sans quoi d’ailleurs il n’y aurait aucune distinction possible, aucune forme ; ce serait le régime de la pure immanence, où tout serait “comme de l’eau dans l’eau”.
Toutefois cette “mêmeté” ne signifie pas que l’identité d’un être est, et reste absolue à travers le temps, d’autant plus pour l’homme dans la mesure où il est parmi tous les êtres vivants, le seul à ne pas être ce qu’il est automatiquement par instinct, par ses gênes. Il est par essence sans essence, ce que disait déjà Heidegger lorsqu’il affirmait que “l’existence précède l’essence”.
C’est dire aussi qu’il a à se faire homme par lui-même, la technique définissant précisément ici ce par et comme quoi l’homme se fait homme ou devient à lui-même sa propre oeuvre. Il s’ensuit que l’homme est dans son essence sans identité, étant entendu toutefois que celle-ci définisse ou suppose la permanence d’une nature, dont la technique signifierait justement l’impossibilité. En fait, la technique “est d’abord le signe et l’effet de notre non-naturalité... La technique supplée la nature là où la nature dévoile “naturellement” sa non-naturalité : dans l’humanité” 2.
Cela étant dit, on s’aperçoit qu’il ne peut exister d’identité pure, que tout ce qui est, dès qu’il est, est soumis au régime de la finitude, c’est-à-dire avant tout à la co-existence, au monde comme co-existence, dans ce monde où il ne cesse d’être soumis à de multiples influences qui en modifient en permanence les limites. Il s’ensuit que l’altérité travaille l’identité, réside en elle, non pas comme un accident, dont elle pourrait se préserver, mais comme sa condition inéluctable. L’indestructible du coup, ce n’est pas l’identité, mais la différence, l’altérité. En ce sens, la pureté n’est qu’une projection ou qu’une fiction, puisque toute chose participe dans sa consistance même d’une imbrication ou d’une articulation d’une multiplicité d’événements, dont elle n’est que l’équilibre et la forme à un moment donné. On n’accéderait en somme à la pureté qu’artificiellement en isolant une chose du contexte dans lequel elle est habituellement impliquée ou co-impliquée. Il va sans dire qu’il en est de même quant aux identités raciales ou culturelles, d’autant plus qu’on sait bien désormais que toute race, toute culture, ou même tout idiome — toute langue —, procède d’un mélange, d’une hybridation, ou d’un métissage préalable. C’est dire du coup qu’à l’origine d’une identité, il n’y a pas la pureté, mais au contraire - comme sa condition de possibilité - le métissage ou l’hybridation, ce qui bien évidemment est intenable pour toute revendication raciste ou ethnico-nationaliste. Exister pourtant relève de l’effort de persister dans son être (le “conatus essendi” de Spinoza), de se maintenir un dans la différence, ou encore de préserver sa structure, c’est-à-dire l’ensemble des relations existant entre les éléments de cet être (ce que la biologie appelle l’“homéostasie”). En ce sens, “nous ne vivons que pour maintenir notre structure biologique, nous sommes programmés depuis l’oeuf fécondé pour cette seule fin, et toute structure vivante n’a pas d’autre raison d’être que d’être” 3.
C’est ici qu’intervient la mémoire, dont la première forme est génétique : tout enfant qui naît porte en lui toute l’expérience passée des espèces qui se sont succédées sur cette terre. Vient ensuite la mémoire nerveuse individuelle ou acquise que tout homme construit par l’intermédiaire notamment du langage tout au long de son existence. L’une et l’autre, certes de manière différente puisque déjà seule la deuxième relève en propre du fait humain, participent ou contribuent à l’équilibre de la structure, à la persistance de ce qui définit son identité.
Aussi, pensons nous, si l’identité comme problème ou question revient aujourd’hui avec tant d’insistance, c’est parce qu’elle se trouve menacée comme jamais jusqu’à alors, tant sur le plan ontologique, c’est-à-dire sur le plan de la structure génétique, que sur le plan existentiel, notamment au niveau du collectif, de l’être-ensemble (sécularisation du mythologique, du religieux, des idiomes et des cultures en général...). Car en effet, la technologie contemporaine offre désormais la possibilité inouïe de modifier la structure même de l’existence humaine, génétiquement 4, par les progrès des biotechnbiotechnologies (chirurgie ou manipulations génétiques, techniques de clonage, nanotechnologies...), aussi bien que culturellement par le développement exponentiel des réseaux de communication à travers l’ensemble de la planète (Internet fournit ici un exemple privilégié). En ce sens, “le réseau électronique et informatique qui s’étend sur la terre donne naissance à une capacité globale de mise en mémoire qu’il faut estimer à l’échelle cosmique, sans commune mesure avec celle des cultures traditionnelles”5.
On s’aperçoit dès lors que ce qui menace l’identité n’est pas, ou n’est plus, l’autre — l’autre identité — (l’Histoire serait le récit de cette opposition ou de ce conflit), mais son absence, sa suspension, ou son absorption dans une globalité qui serait celle du monde dans sa totalité.
En somme, la mutation récente de la technique, de l’ère mécanique à celle électronique ou numérique, bouleverserait les données géopolitiques du monde (sa carte ou ses frontières), en ce qu’elle tendrait progressivement à homogénéiser sa temporalité et sa spatialité, poussant ainsi les identités ethniconationales
qui le fragmentaient à se métisser, et par là même à composer un unique territoire, une unique identité, dont il resterait à inventer la mémoire, ou du moins à se l’approprier. La technique serait ainsi à l’origine d’une sorte de déracinement, d’arrachement au contexte local — temps et territoire — qui fait l’histoire de ces identités ethniques, et dans lequel s’inscrit leur mémoire par laquelle précisément elles fondent leur identité et inventent leur culture comme cette mémoire même. En les reliant, et en les ouvrant les unes aux autres, elle engagerait alors ces identités à s’hybrider, et à mettre en commun leur mémoire respective par quoi précisément elles s’identifient, de telle sorte que ce processus d’ouverture réciproque soit amené à les articuler ensemble, et à les fusionner dans une forme plus complexe. Leroi-Gourhan montre en effet que la technique dans son déploiement s’oppose nécessairement au repli identitaire qui caractérise les ethnies. Plus encore, dans le conflit “technique-ethnique” qu’elle initierait, elle les conduirait à se confondre dans une “méga ethnie”. Le passage des identités ethniques à une identité globale, mondiale, serait en quelque sorte compris ou inscrit dans la technique, comme sa propre fin, comme son
télos même, dont la réalité serait effective dans sa forme numérique, à savoir dans l’extériorisation complète du système nerveux humain. Ainsi, même “s’il est exact que l’espèce soit la forme caractéristique du groupement animal et l’ethnie celle du groupement des hommes, (et qu’) à chacun des corps de traditions doit correspondre une forme de mémoire particulière” 6, il faut reconnaître en même temps que cette mémoire — par la logique même de la technique —, est vouée à disparaître, à se faire en quelque sorte absorber dans une forme plus complexe et plus globale. En fait, cette “mémoire particulière” constitue ou définit l’identité même de chaque ethnie, ce par quoi elle s’identifie et se reconnaît, ce qu’on pourrait aussi appeler sa culture, comme une sorte de mémoire collective rendant possible la communication entre ses membres. Or le développement de la technique entraîne une “libération de la mémoire”, qui du stade génétique au stade nerveux individuel, passe à celui de technologique (sa figure la plus complexe), dans lequel le système nerveux s’extériorise à l’échelle planétaire dans la multiplicité des réseaux électroniques, qui tendent désormais à innerver le monde dans sa globalité. Autrement dit, la mémoire de chaque identité ethnique ou ethnico-nationale est engagée de manière irrésistible dans un processus de déterritorialisation et de détemporalisation (de déracinement ou d’arrachement au contexte local où se fonde toute culture), au sein duquel elle est amenée à se suspendre et à composer avec la totalité des autres une sorte de méga mémoire qui serait celle de l’homme mondial. En somme, en passant de l’ère mécanique à celle électronique, la technique (que Bernard Stiegler commentant Leroi-Gourhan qualifie en ce sens de “transethnique”) amplifie ou accélère ce processus d’extériorisation et de libération de la mémoire, et de la sorte est en passe de créer lapossibilité inouïe pour les hommes de partager, sous la forme électronique, une mémoire commune.
Il pourrait cependant paraître pour le moins paradoxal - si ce n’est, quant à la décence de la pensée, déplacé, voire scandaleux - que ce discours sur le devenir global du monde, ou sur le métissage des cultures et des identités, se tienne à la face de ce même monde, où la réalité la plus quotidienne nous confronte en même temps à une multiplicité de conflits ethniques ethniques et de crispations identitaires, où justement l’identité semble plus que jamais revendiquée, voire exacerbée. D’autant plus qu’à cette myriade de réactions identitaires viendraient s’ajouter ou se coupler le développement, bien réel lui aussi, d’une multiplicité d’autres identités, bien plus fluides et éphémères que celles qui procèdent de l’enracinement dans un contexte local et historique, à savoir celui d’une constellation polymorphe et hétérogène de minorités transversales, n’ayant plus leur fondement dans le théologico-politique, mais dans des agrégations ou appartenances esthétiques, sexuelles ou autres, prenant forme dans ce que le sociologue Michel Maffesoli a appelé des “tribus” 7.
Mais il nous semble pourtant que cette résurgence des nationalismes ou que cette exaltation actuelle des identités ethniques, culturelles, des communautés locales ou des minorités de tout bord, ainsi d’ailleurs que cette actuelle “tribalisation” du monde, loin d’infirmer son devenir global, le confirme plutôt, en ce qu’elles constitueraient pour ainsi dire une ré-action à son effectuation, comme si elles venaient témoigner par la négative de ce qu’il menaçait concrètement la perdurance de ces formations identitaires. Et en effet, “c’est au moment même où ce qui prend la forme d’échanges, de rencontres, de communication..., s’intensifie, expose les identités nationales au moins supposées aux influences, aux greffes, aux déformations, aux hybridations, etc., c’est à ce moment là que la conscience nationale, la recherche d’identité, l’affirmation, voire la revendication nationale, se manifeste davantage, voire s’exaspère et tourne à la crispation nationaliste” 8.
D’autre part, mais d’une manière différente, cette globalisation due au développement des nouvelles technologies de communication — au processus de déterritorialisation et par là de métissage qu’elles impliquent —, recréerait paradoxalement des identités dans la suspension même des identités ethniconationales, du moins de toutes celles qui sont enracinées dans un territoire, comme si cette déterritorialisation poussait l’êtreensemble à se reformuler différemment dans des configurations communautaires autres que celles qui relèvent de l’appartenance, c’est-à-dire de l’identification à un sol, à un sang, à une race, à une ethnie, à un peuple, à une nation, ou à une culture, à une religion, à un mythe...Ou pour le dire autrement, l’identité — sa réalité effective — tendrait en somme à glisser ou à muter de l’appartenance à l’élection comme forme de partage d’une communauté ou d’un être-ensemble non-territorial ou a-territorial, c’est-à-dire trans-ethnique ou trans-national, pour autant toutefois qu’on puisse encore parler d’ethnie ou de nation. Et on peut déjà penser là à toutes ces petites communautés ou micro-groupes qui se tissent à travers Internet par exemple, autour de passions, d’émotions, ou de préoccupations communes. Découlant elle aussi, tout comme la crispation ethnico-nationale,de la globalisation actuelle du monde, cette tendance à la fragmentation s’y opposerait toutefois radicalement, dans la mesure où elle accélérerait en quelque sorte cette chute en désuétude des identités politiques traditionnelles, concrétisée dans le mouvement contemporain de “dépassement de l’identité vers les identifications” 9. Car il se peut en effet que ce surgissement actuel d’une multiplicité de “tribus”, ne se
produise pas seulement au sein des communautés traditionnelles, mais dans leur disparition, et peut-être même comme leur disparition ; l’un et l’autre étant intimement et nécessairement liés, comme si aussi surgissait là en même temps — ce qui resterait à analyser avec plus de précision —, le signe pour l’homme d’un besoin intempestif de la forme identitaire, fut-elle totalement arrachée ou extraite d’un contexte local ou d’un territoire. Ainsi, si le “tribalisme moderne souligne bien l’éclatement des sociétés homogènes” 10, il se peut également qu’il souligne aussi en lui l’impossibilité pour l’homme de ne pas se reconnaître lié, quand bien même ce serait dans des formes éphémères et aterritoriales, dans des identités, d’autant plus d’ailleurs que d’un autre côté, on est bien en peine de savoir quelle est l’identité de ce monde global, auquel et dans lequel il est pour le moins difficile de s’identifier. Toujours est-il que l’apparition de ces “tribus”, ou de ce que Bernard Stiegler nomme des “communautés idiomatiques non-territoriales” ou Hakim Bey des “TAZ” (“zones d’autonomie temporaire”), témoigne de ce que le devenir mondial du monde ne réduit pas nécessairement le “métissage” qu’il entraîne à une totalité amorphe, où se suspendraient de manière inéluctable toutes les différences, mais qu’au contraire elles y trouveraient la possibilité de se figurer et d’y proliférer, mais seulement sous d’autres formes que celles des identités territoriales traditionnelles, dont la tendance est à l’enracinement, et non au nomadisme.
Il n’empêche qu’on est en droit de se questionner sur la nature même de cette “mondialité”, quant à savoir déjà si sa réalité actuelle incarnée dans ce qu’on appelle le “Village global”, n’est pas une autre figure de cette dialectique historique selon laquelle l’universel, ou du moins la prétention à l’universel, n’est et n’a jamais été que la dissimulation d’un particularisme national, voire ici international, se présentant comme tel. Et en effet, l’Histoire, et en particulier celle de l’Occident, n’aura en fin de compte jamais été que le miroir de cette dialectique singulière, au sein de laquelle les identités nationales se sont toujours érigées en modèle universel, comme si tout l’homme, tout le monde dans son humanité même s’y résorbait ou s’y incarnait, renvoyant du coup l’autre à la non-humanité, à la barbarie 11.
En ce sens, ce qu’implique cette dialectique, c’est que “la valeur d’universalité doit se lier à celle d’exemplarité qui inscrit l’universalité dans le corps propre d’une singularité, d’un idiome ou d’une culture, que cette singularité soit ou non nationale, étatique, fédérale ou confédérale (...) L’auto-affirmation d’une identité prétend toujours répondre à l’assignation de l’universel.” 12.
En d’autres termes, pour préciser ici notre pensée, il se peut que ce “Village global” ne soit en définitive que l’autre face del’ultra-libéralisme occidental, voire américain, c’est-à-dire encore une fois une figure singulière ou particulière érigée en modèle universel. Ce que tentait d’ailleurs de justifier Francis Fukuyama, philosophe-théoricien du Pentagone, lorsqu’il entendait montrer que “la démocratie libérale”, c’est-à-dire l’ultra-libéralisme, constitue dans un schéma hégélien “la fin de l’Histoire”, son ultime figure, dans laquelle s’accomplirait ou se réaliserait l’essence même de l’humanité 13. Il ne s’agit pas cependant de céder à une sorte d’anti-américanisme, fort en vogue aujourd’hui, ce qui serait somme toute une autre manière de s’abandonner à une crispation elle-même identitaire, ni même de tenter de préserver ou de sauvegarder à tout prix notre identité européenne au nom d’une authenticité ou d’un modèle plus défendable. En ce sens, si ce qui nous arrive, c’est bien le monde comme espace de notre être-en-commun, la question qui surgit de cet événement nous porte en même temps à nous demander si cette mondialité nous arrive comme la reprise à l’échelle planétaire de la lutte identitaire, au sein de laquelle une identité singulière se projette comme incarnation de l’universel, ou plutôt comme le lieu ouvert de l’absence, du défaut d’identité, de sa suspension ou de son perpétuel métissage ?
Une autre question d’ailleurs se profile ici, pour autant que sous les feux croisés de cette dichotomie contemporaine, s’engendrant entre l’éloge parfois naïf du global, de l’universel ou du métissage (qui serait censé nous arriver), et sa critique crispée (témoignant souvent d’une frilosité aveugle et autiste, prostrée dans la seule revendication de l’identité d’appartenance ethnique, nationale, religieuse ou raciale, et surtout dans la nécessité d’en préserver à tout prix la pureté supposée), il semble nécessaire de se demander d’où vient en effet — qu’est-ce qui la fonde et la justifie — cette affirmation d’une supériorité de l’ universel ? Pourquoi d’abord l’universel serait supérieur au particulier, le Monde aux Nations, le global au local ? Du moins cela pourrait paraître indispensable si, comme nous l’avions vu précédemment, le devenir mondial ou global du monde n’était d’abord et avant tout, avant d’être en quoi que ce soit notre oeuvre, l’ultime conséquence de notre défaut d’être, de notre prosthéticité ou de notre non-naturalité originaire, c’est-à-dire en fin de compte de la technique, et de ses développements actuels. Ajoutons à cela que d’une part, l’universel ou le global ne signifie pas nécessairement l’a-topique, l’a-territorial, c’est-à-dire le sans-lieu, ne serait-ce déjà aussi que parce que le monde reste bel et bien un lieu, si ce n’est à vrai dire notre seul lieu, à nous les hommes ; et que d’autre part, ce qui nous paraît dès le départ grevé ou faussé dans ce débat, c’est aussi l’ignorance et l’aveuglement devant
le fait que ce qui est en jeu dans notre présent, ce n’est peut-être pas l’opposition tranchée entre l’un et l’autre (le global ou le local...), mais bien plus profondément le mouvement ou le passage dialectisé entre les deux, c’est-à-dire ce qui ne se cristallise pas ou ne se fige pas dans l’un des deux pôles, mais se nourrit sans cesse de l’altérité de l’autre, en laissant en quelque sorte la différence s’épanouir en soi 14. Qu’est-ce que serait en effet un monde qui ne se construirait pas sur et avec les différences qui y prolifèrent et le constituent, sinon un monde sans profondeur et sans saveur, un monde vide, anesthésié et sans vie ? Et qu’est-ce que serait une identité particulière qui ne s’ouvrirait pas au monde des autres identités, sinon une entité aussitôt vouée à la disparition, à l’auto-effacement ou à l’auto-enfermement autiste et suicidaire ? Replié, clôturé dans son identité, l’être se ferme, s’anesthésie, et se vide de toute vitalité.
Il n’en reste pas moins que sous la figure du “Village global”, cette mondialité, parce qu’elle advient hors contexte, hors de toute inscription dans un territoire, fait naître un monde sans véritable mémoire partagée. Car cette dernière, incarnée dans l’ensemble des réseaux de communication que les nouvelles technologies ne cessent de multiplier à travers la planète, et où se retrouvent mises à disposition toutes les cultures, tous les patrimoines, parce qu’elle ne peut les conserver qu’arrachés du contexte qui les a fait naître, est sans profondeur et sans appartenance. C’est en quelque sorte la mémoire de personne, une mémoire pour ainsi dire effacée, sans identité ou en tout cas en attente d’identification. Il nous appartiendrait alors de mettre au jour ce que pourrait être le partage d’un monde à penser entre son actuelle globalité (le “Village global” comme amnésie), et la crispation ou le repli identitaire (le retour à l’origine où se fonde l’identité comme nostalgie). Car à vrai dire, l’un et l’autre ne sont en fait ni plus ni moins que l’étouffement de la mémoire, l’un par manque ou par défaut, l’autre par excès ou saturation : ce qui se perd alors, c’est l’altérité ou la différence, qui fait aussi et peut-être surtout, quand bien même elle serait à envisager à l’échelle mondiale, le propre d’une culture, du moins s’il faut entendre par-là autre chose que la perpétuation ou la préservation d’un patrimoine, qui ferait signe vers la création comme invention et invitation de la différence. Aucune création n’est en effet possible dans le seul repli sur soi qui enferme la différence dans l’un, et l’autre dans le même. Créer, penser, n’est-ce pas toujours le faire en même temps contre la néguentropie d’une identité ou en général du Même ? Et c’est déjà en ce sens que la technique et l’art communiquent, et participent du même élan ou du même geste, comme le signifiait déjà le nom grec de techné : faire advenir du nouveau, rompre les limites, accueillir l’autre dans le même.
A quoi pourrait alors ressembler cette identité globale à inventer entre l’absence d’identité (l’amnésie comme totalité amorphe), et l’exacerbation de l’identité (la nostalgie comme repli paranoïaque sur soi) ? Comment penser en quelque sorte non pas l’absence d’identité, mais une “identité absente”15, inappropriable, infigurable, ouverte, qui ne cesserait de se recomposer dans la différence, et d’advenir au-delà de tout ce qui tendrait à la figer sur ses propres limites, cette venue faisant le nous ou l’avec du monde, son partage ? Car il se peut en effet que ce qui se joue là, dans événement ou l’avènement du monde, relève précisément de ce qui est sans identité, ou du moins de ce dont l’identité n’est jamais achevée, ne peut être achevée, sans être en même temps l’exclusion de toute altérité ou différence, leur violente réduction à de l’identique, c’est-àdire ni plus ni moins que l’extension au niveau mondial du modèle totalitaire. Telle serait sans doute la question qui nous serait adressée depuis ce devenir monde du monde.
Michel Gaillot
1) Maurice Blondel, Lalande, dictionnaire philosophique, p. 454.
2) Jean-Luc Nancy, «L’artisanat du sans fin», in Artiste, et après ?, entretien avec Camille Saint-Jacques, Ed Jacqueline Chambon, 1998, pp 86-87.
3) Henri Laborit, Eloge de la fuite, Gallimard, Paris, 1972, p. 72.
4) Nous ne traiterons pas ici de toute la problématique que fait naître la possibilité inouïe de modifier la mémoire génétique de l’être humain, même si c’est avant tout par elle que son identité se trouve pour ainsi dire levée ou suspendue, dans la mesure où elle le fait passer de l’ «être» au «possible», du «réel» au «virtuel», puisque dorénavant par les biotechnologies, il devient possible de modifier cette mémoire qui jusqu’ici ne pouvait «recevoir de leçons de l’expérience» (Voir François Jacob, La logique du vivant, Gallimard, 1970,p 11.)
5) Jean-François Lyotard, L’Inhumain. Causeries sur le temps, Ed Galilée, Collection Débats, Paris, 1988, p 76.
6) André Leroi-Gourhan, Le geste et la parole. Tome II. La mémoire et les rythmes, Albin Michel, Paris, 1965, p. 12.
7) Voir notamment Le temps des tribus, Ed Méridiens Klincksiek, Paris, 1988 et Au creux des apparences, Le Livre de Poche, Plon,1990.
8) Jacques Derrida, Le Nationalisme et ses revenants, Conférence de Moscou, Collège Universitaire Français, texte inédit, Mars 1994.
9) Michel Maffesoli, Des effervescences festives, entretien avec Michel Gaillot, in Blocnotes, n° 13, oct 1996, p 71.
10) Michel Maffesoli, Du Nomadisme, Le Livre de Poche, Paris, 1997, p15.
11) C’est ainsi déjà que Hegel considérait le «peuple», «l’individu qui est un monde», comme le modèle même de l’Universel : «l’Esprit du Monde...est toujours absolu, et dans chaque peuple, dans ses moeurs et ses lois, il trouve son essence et jouit de soi-même.» Des manières de traiter scientifiquement du droit naturel, trad B Bourgeois, Vrin, 1972, p 404.
12) Jacques Derrida, L’autre cap , article paru dans Le Monde , août 1990, publié aux Editions de Minuit, en 1991.
13) Voir La Fin de l’Histoire et le Dernier Homme , trad D-A Canal, Flammarion, 1993
14) En un sens, la part majeure de la pensée contemporaine de Bataille à Deleuze, en passant par Lévinas, Blanchot, Derrida ou Nancy, pour n’en citer que quelques uns, participe de la tentative de penser ou d’accueillir cette différence (qui peut y prendre différents noms, dont celui bien sûr de différance ...), c’est-à-dire de ce qui ne peut se laisser déterminer, approprier, et circonscrire dans la figure du Même ou de
l’Un. C’est aussi du coup la tentative de sortir de Hegel, du système hégélien au sein duquel l’identité est toujours absorption de la différence : «l’identité est l’identité de l’identité et de la différence».
15) Il faudrait alors essayer de penser l’identité du monde comme Blanchot pense celle du sens, lorsqu’il parle dans L’écriture du désastre, de «sens absent», c’est-à-dire non pas le nihilisme -l’absence de sens-, mais un sens ouvert, qui ne se laisse ni figurer, ni approprier. On pourrait d’ailleurs montrer que penser l’identité du monde, ce n’est en définitive rien d’autre que de penser le sens, ce qu’on a en partage et ce qui nous partage.